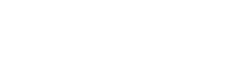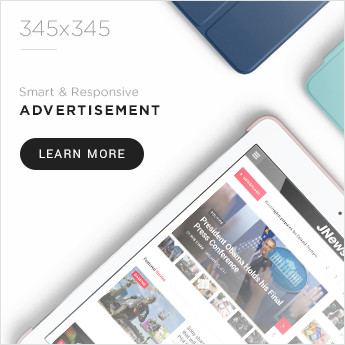La Coupe du Monde de la FIFA 2026 sera le plus grand tournoi de football jamais organisé, avec seize villes hôtes aux États-Unis, au Canada et au Mexique, quarante-huit équipes et cent quatre matchs. Il marque un tournant décisif tant par son envergure sportive que par la responsabilité environnementale qu’il implique. Les experts prévoient que l’empreinte carbone du tournoi pourrait approcher les quatre millions de tonnes de CO₂, principalement à cause des déplacements aériens, estimés à quatre-vingt-cinq pour cent des émissions. Bien que l’utilisation de stades existants contribue à limiter les émissions liées aux constructions, l’ampleur géographique du tournoi soulève de sérieuses préoccupations écologiques.
FIFA a mis en place une Stratégie de Durabilité et Droits Humains pour 2026 afin de relever ces défis. Ce cadre impose aux villes hôtes de se conformer à la norme ISO 20121 en matière de gestion durable des événements, veillant à la gestion de l’énergie, à la réduction des déchets et à l’organisation sur toute la durée du tournoi. Houston prévoit d’introduire un système de gestion durable avec un manuel opérationnel pour les futurs événements. Dallas s’engage à utiliser des infrastructures vertes certifiées LEED, des transports électriques, le recyclage et le tourisme écologique. Quant à Seattle Stadium, il vise à atteindre une gestion sans déchets et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre grâce à l’énergie solaire et à un programme efficace de gestion des déchets. Ces initiatives reflètent une ambition commune : faire de cette coupe du monde un événement majeur respectueux de l’environnement.
Cependant, la crédibilité environnementale du tournoi est remise en question. Les critiques dénoncent le recours de FIFA à la compensation carbone, notamment la prétendue neutralité carbone de 2022, jugée peu transparente. Beaucoup demandent une véritable réduction des émissions, des rapports transparents et moins de dépendance aux crédits de carbone pour éviter une stratégie de façade. À l’inverse, l’approche adoptée par l’UEFA lors de l’Euro 2024 était plus tangible : l’utilisation d’infrastructures existantes, l’efficacité énergétique et le transport public ont permis une réduction de 21 % des émissions. Un modèle que FIFA pourrait s’inspirer.
En conclusion, la Coupe du Monde 2026 est à la croisée des chemins. Elle pourrait devenir une référence en matière d’écologie pour les méga-événements sportifs ou un avertissement des conséquences de l’inaction environnementale. L’issue dépendra de la transparence, de la planification ambitieuse et d’un engagement véritable envers la durabilité de la part de tous les acteurs impliqués.